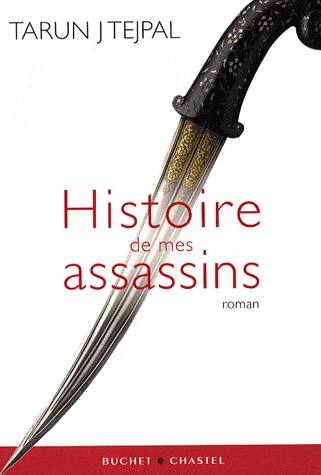Pour terminer avec ce mois de Janvier et mes critiques de romans- termes que je préfère concernant mes articles à critiques littéraires n’ayant pas la prétention de connaître par cœur l’œuvre des auteurs auxquels je m’attaque - voici un auteur que j’ai lu pour la première fois il y a très peu, Julien Gracq. J’avais lu il y a quelques années un magazine littéraire qui lui était consacré, peut-être était-ce pour sa mort en 2007.
Pour terminer avec ce mois de Janvier et mes critiques de romans- termes que je préfère concernant mes articles à critiques littéraires n’ayant pas la prétention de connaître par cœur l’œuvre des auteurs auxquels je m’attaque - voici un auteur que j’ai lu pour la première fois il y a très peu, Julien Gracq. J’avais lu il y a quelques années un magazine littéraire qui lui était consacré, peut-être était-ce pour sa mort en 2007.A l’époque j’avais été surpris et charmé par une interview, où ne se jugeant plus assez réactif pour répondre à une interview en direct avec la dose de subtilité qu’il aurait souhaité y mettre, il avait demandé qu’on lui envoie les questions pour y répondre par écrit. Cette interview était de ce fait particulièrement dense et intéressante, ne laissant en rien présager que l’âge eut pu affecter les capacités de réflexion de l’auteur aimé unanimement par la critique littéraire. Son œuvre est dite protéiforme et s’est, selon les articles que j’ai pu en lire, imposée sans avoir recours à l’affiliation à un quelconque courant.
J’ai donc commencé par le début en prenant son premier roman Au Château d’Argol ne sachant pas du tout à quoi m’attendre. Achevé en 1937, il a été comme c’était d’usage à l’époque pour les brillants auteurs refusé par Gallimard mais publié en 1939 par l’éditeur José Corti auquel il sera toujours resté fidèle. Un des plus beaux exemples de relation et d’amitié entre un écrivain et son éditeur. Pour les lecteurs en revanche il est plus difficile de trouver ses œuvres qui n’ont pas été éditées en poche et que vous trouvez en livre José Corti (pour ceux qui n’ont jamais lu au coupe-papier pensez-y) ou en collection de la Pléiade. Hélas toutes ces éditions sont un peu plus coûteuses qu’un livre de poche mais sans doute le trouverez-vous dans les bibliothèques.
Ce qui m’a surpris dans ce roman fut le ton résolument romantique et j’ai dû vérifier la date de publication et celles de vie de l’auteur ayant réellement l’impression au premier abord d’être en plein 19e siècle, au coin d’une cheminée imposante, le tonnerre vrombissant et les éclairs illuminant les moustaches de ce chat qui miaulait étrangement comme hypnotisé par les oscillations des ombres projetées des arbres sur la tapisserie du salon en velours sombre. Pardon, je me suis égaré. Reprenons. Cet ouvrage semble romantique, et on a l’impression à tout moment qu’un vampire pourrait surgir de cette extrêmement dense forêt où le héros sur le conseil d’un ami a acheté un vieux château sans l’avoir visité. La nature l’ensorcelle et il semble se nouer entre lui et elle un pacte obscur qui verra son dénouement à la fin de l’histoire. L’ami fidèle ayant conseillé notre héros d’acquérir cette demeure ancestrale et énigmatique, comme si elle avait une âme noire, arrive dans ce lieu reculé pour lui rendre visite mais n’arrive pas seul. L’élément perturbateur n’est absolument pas dissimulé mais incarné par la charmante jeune femme qui sera le sujet d’embrasement et de discorde des deux amis.
Une histoire simple certes, mais une mise en scène et une écriture qui vous ensorcellent tout en vous mettant mal à l’aise, ayant peur à tout instant qu’un drame empreinte le long sentier et vienne toquer à la lourde porte.
Cette nature qui m’avait prévenu dès le début du roman en se manifestant lors d’une ballade sur la plage semble être un incubateur de passions bien plus violentes que celles communément écrites au 20e siècle. La multiplication des adjectifs (qui semblent pour certains même hors d’usage) et des descriptions est mystifiante.
Un magnifique travail d’écrivain qui ne peut que donner envie de lire la suite de œuvres de Gracq, tout en laissant quelques instants un frisson passer dans le dos du lecteur.